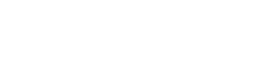Monastère de San Pelayo
- Titre Oviedo Centre des Asturies
- Adresse Adresse: C/ San Vicente ■ 33003 - Oviedo/Uviéu
- Téléphone Téléphone: 985 218 981
- E-mail E-mail: mspelayo@telefonica.net
- Site Site: http://www.monasteriosanpelayo.com/
- Époque Époque: Baroque
- Gestion Gestion: Ecclésiastique
Informations
Le monastère bénédictin de San Pelayo a été fondé à l'époque médiévale sous le patronage de San Juan Bautista. Cependant, avec le transfert des restes de San Pelayo à Oviedo/Uviéu pour être déposés dans ce couvent, il a changé de nom pour devenir le monastère de San Pelayo.
Il s'agit d'un couvent cloîtré qui fait partie de l'histoire des Asturies, puisqu'en mille ans d'existence, il a réussi à rassembler une importante collection de documents et qu'il sert actuellement d'archives historiques provinciales. Les religieuses qui l'occupent sont traditionnellement connues sous le nom de Pelayas.
Dans ses splendides archives se trouvent les collections des monastères de San Bartolomé de Nava, Santa María de Villamayor, San Vicente et Santa María de la Vega, ainsi que de nombreux objets et reliques qui ont fait partie du couvent.
L'église a été construite entre 1592 et 1600. Son plan est simple, avec une seule nef et aucune chapelle. La façade, entre les murs latéraux et sur un escalier allongé, est de construction simple, construite avec des pierres de taille parfaitement équarries. Elle est composée de trois portes avec des moulures, celle du centre étant la plus haute. Au-dessus de celle-ci se trouve une grande niche avec une figure en pierre de San Pelayo et une rosace vitrée. L'intérieur est magnifié par les stalles du chœur provenant de l'ancien couvent de San Vicente. Sculptées sur bois à la fin du XVIe siècle, elles sont d'une facture simple et d'un style maniériste. Il se compose de trente-six sièges hauts, dont les dossiers présentent un vaste répertoire iconographique où sont représentés des rois et des empereurs.
En 1703, l'imposante façade du presbytère a été conçue sur la base des palais baroques. Le rez-de-chaussée est organisé avec trois grands arcs entre des colonnes toscanes indépendantes, qui soutiennent les balcons du premier étage, balcons décorés de moulures à oreilles entre des colonnes ioniques. Au premier étage se trouvent les armoiries de l'ordre bénédictin, au-dessous des armoiries royales, qui se trouvent dans un attique proéminent sous un fronton courbé et entre deux colonnes corinthiennes.
Le cloître s'élève sur trois étages, ce qui en fait une construction massive avec un certain air monumental. Comme l'église, le cloître est soutenu par des piliers et des colonnes toscanes.
Au XVIIe siècle, l'ancien clocher a été remplacé par une nouvelle tour surmontée d'une flèche gothique à tracer, qui reproduit la verticalité de la tour de la cathédrale dans des dimensions plus réduites.